In Préfaces :
Accéder au site source de notre article.
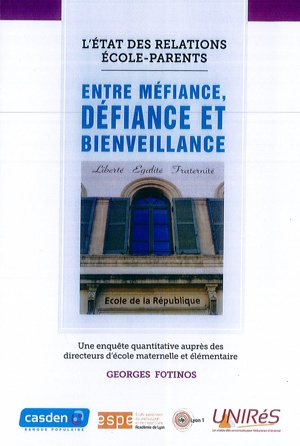
Pour un nouveau contrat entre les parents et l’école
(contribution à l’enquête de Georges Fotinos – L’état des relations école-parents – Entre méfiance, défiance et bienveillance)
Les relations entre la famille et l’École sont, en France, particulièrement complexes. En effet, selon l’historien Philippe Ariès (1), au Moyen-Age les parents ne développaient aucun intérêt particulier pour l’avenir de leur progéniture. Dès qu’il pouvait vivre loin des soins permanents de sa mère, l’enfant était projeté sans ménagement dans le monde des adultes où il survivait tant bien que mal… C’est seulement à partir du 17ème siècle qu’émerge la responsabilité éducative, et, avec elle, simultanément, le « sentiment familial » et le projet scolaire. L’enfant devient ainsi l’objet d’une sollicitude qui ne cessera de grandir et s’exprime, tout autant, par le souci de son hygiène, puis de sa santé physique et psychique, que par la volonté de le préserver de toutes les formes d’agression qui pourraient entraver son développement et, enfin, par la création d’institutions chargées spécifiquement d’assurer sa bonne éducation. Ainsi l’école apparaît-elle comme une manifestation de l’intérêt de la famille pour le sort de ses enfants et le prolongement, en quelque sorte, de son engagement éducatif : « La famille et l’école ont ensemble retiré l’enfant de la société des adultes », écrit Philippe Ariès : elles ont fait alliance, au nom de l’amour qu’elles lui portaient et se sont réparties les tâches éducatives « dans son intérêt ». Au point que l’émergence de la famille moderne, attachée à l’avenir de ses enfants, et la scolarisation massive de la jeunesse peuvent apparaître comme deux phénomènes corollaires, et, même, comme l’expression d’un même projet social. Cette scolarisation est, bien sûr, essentiellement confessionnelle et, à l’exception de quelques privilégiés qui pratiquent le préceptorat ou mettent leurs enfants dans de rares établissements d’élite, la grande masse de la jeunesse est scolarisée dans des écoles populaires sous le signe de l’hétérogénéité des âges comme des origines…
Mais, bien évidemment, les familles ne vont pas tarder à se différencier : dès le 18ème siècle, la bourgeoisie « n’a plus supporté, pour ses enfants, la pression de la multitude et le contact avec le peuple : elle fait sécession, se retire de la vaste société polymorphe pour s’organiser à part, en milieu homogène (…), dans des quartiers neufs, avec ses écoles propres, gardées de toute contamination populaire » poursuit Philippe Ariès. C’est le début d’un vaste mouvement de ségrégation sociale et scolaire qui va se poursuivre tout au long des 18ème et 19ème siècles. La Révolution française passe par là : les révolutionnaires s’insurgent contre le phénomène, rédigent de superbes projets, comme celui de Condorcet, mais, accaparée par d’autres urgences, ne procède à aucune véritable réforme scolaire. Napoléon – on le sait – crée les lycées, mais ne fait, en réalité, que renforcer la ségrégation en offrant à la bourgeoisie un instrument de promotion institutionnelle qui lui permet d’asseoir son emprise sur la Nation. En fait, c’est Guizot, ministre de l’Instruction publique en 1832 – sous la Monarchie de juillet – qui fut le premier grand architecte de notre système éducatif : en quinze ans, sous son influence, le nombre d’écoles primaires grimpe de dix mille à vingt-trois mille ; il crée les Écoles normales pour former les maîtres, les inspecteurs pour en contrôler le travail et promeut l’ancêtre de notre « Bulletin officiel » afin de garantir l’unité d’un système qu’il veut délibérément pyramidal. Mais, surtout, Guizot impose le « modèle simultané » (la classe homogène d’élèves du même âge qui obéissent ensemble au même maître et font la même chose en même temps) contre « l’enseignement mutuel » (où les classes sont constitués d’élèves plus nombreux et d’âges différents dont le travail est organisé en petits groupes sous la responsabilité de moniteurs plus avancés)… et cette décision structure toujours notre système scolaire. L’ambition de Guizot : dans ce qu’il nommait lui-même sa « lutte tenace contre toute forme d’anarchie », il veut donner une École à l’État pour donner à l’État plus de force et d’autorité ; il se fait fort de contenir, par un système scolaire puissant et centralisé, toute velléité de soulèvement populaire et de maîtriser les forces centrifuges pour permettre à la France d’être la plus puissante Nation d’Europe. Ainsi, déjà, l’École devient une « affaire d’État » : l’unité de ce dernier doit l’emporter sur les factions et les intérêts qui s’affrontent. Pas question bien sûr, pour Guizot, de mettre en place une « école unique », de s’attaquer aux écoles confessionnelles ni de revendiquer le principe de laïcité, mais le mouvement est engagé : les prérogatives des familles doivent s’effacer derrière l’intérêt supérieur du pays.
Avec Jules Ferry, un pas de plus – décisif – est franchi : certes, ce dernier demande aux instituteurs de ne rien dire qui puisse choquer le moindre père de famille… certes, il veut que l’École promeuve « la bonne vieille morale de nos pères »… mais, traumatisé par la capitulation de 1870 et la Commune de 1871, il tient à faire de l’École un instrument aux mains de l’État, une institution capable de fonder la République sur le sentiment d’appartenance à une Nation. À l’École, donc, la responsabilité de la construction de l’unité nationale : il faut reconquérir l’Alsace et la Lorraine, constituer une armée coloniale efficace et éviter à tout prix les affrontements susceptibles d’affaiblir le pays. Pas question d’égalité sociale, mais une véritable mobilisation collective au service d’une entreprise d’homogénéisation idéologique sans précédent…
Dans ce cadre, les familles ne sont pas considérées comme des « ennemies », mais peuvent représenter des « obstacles » : en effet, elles parlent, le plus souvent, le patois, quand on voudrait que tous les petits Français parlent la langue nationale ; elles défendent la transmission de leurs biens et de leurs privilèges quand la République voudrait promouvoir la méritocratie pour donner à chacun l’espoir d’accéder à la classe dirigeante ; elles sont le lieu de l’affectivité, incitent à la pratique religieuse, transmettent parfois des superstitions locales, quand il conviendrait de faire accéder tous les enfants à la rationalité, de conforter leur foi dans le progrès par la science et de les faire adhérer à des « vérités universelles ». L’École a donc bien une fonction d’ « arrachement » par rapport à la famille, arrachement nécessaire pour construire l’unité de la France… dont on éprouvera bientôt la solidité, dans les tranchées de la Grande Guerre. Bref, face à la famille qui porte essentiellement des valeurs d’enracinement et se structure sur une solidarité affective horizontale, l’École doit permettre à tous les enfants d’adhérer aux valeurs de la République, de se mobiliser sur un enjeu national vertical qui transcende les intérêts particuliers, et d’être ainsi disponibles – indépendamment de leurs appartenances et affinités – à l’appel de la Nation.
Mais cette position – dont il faut comprendre la profonde cohérence – est loin d’être réductible au contexte historique de son émergence. Elle a aussi une vraie dimension pédagogique que le philosophe Alain développera longuement dans ses Propos sur l’éducation (2) : « L’école fait contraste avec la famille, explique-t-il, et ce contraste même réveille l’enfant de ce sommeil biologique et de cet instinct familial qui se referme sur lui-même ».Car, quoique la famille soit le lieu nécessaire de la filiation, là où l’enfant s’origine psychiquement et historiquement, là où des adultes, au plus près de ses besoins, lui fournissent les premiers soins et lui donnent les repères nécessaires à son développement, elle ne peut pas, pour autant, suffire à son éducation : il faut que l’enfant « sorte du cercle », découvre qu’il existe d’autres enfants et d’autres familles, que le monde ne s’arrête pas à la sphère privée, que les principes qui régissent sa vie sont discutables et que l’intensité des relations affectives qu’il entretient avec ses parents et sa fratrie ne garantissent pas nécessairement la validité des références dans lesquelles il a été élevé. Il faut que l’enfant puisse rencontrer d’autres modes de raisonnement, être confronté à des objets, des langages, des systèmes qui lui ouvrent l’horizon et lui permette de réexaminer sur un autre mode – plus distancié – la transmission familiale. À cet égard, l’École est non seulement nécessaire pour lui permettre d’accéder à des savoirs beaucoup plus larges et exhaustifs que ceux qui lui sont transmis par son environnement immédiat, mais elle est un outil essentiel pour son émancipation : non qu’elle contraigne l’enfant à « trahir » sa famille, mais parce qu’elle lui donne les moyens de se positionner librement par rapport à elle, non plus dans le registre de l’emprise affective, mais dans celui de la reconnaissance éclairée de son apport, avec la possibilité, à terme, de devenir lui-même – en conscience de sa propre histoire – l’auteur de sa propre vie.
Et l’on ne peut pas vraiment comprendre les relations entre les parents et l’École en France si l’on ne mesure pas l’importance de cette dimension émancipatrice de l’institution scolaire, si l’on ne voit pas à quel point elle a profondément imprégné le corps enseignant et les cadres éducatifs jusqu’à fonder un « contrat » tacite entre les deux partenaires : aux familles la responsabilité du « soin », aux enseignants celle des « savoirs » ; aux familles, l’accompagnement matériel et psychologique des enfants, aux enseignants, la confrontation – parfois violente mais nécessaire – avec l’exigence d’objectivité et de vérité ; aux familles le devoir de rester dans la sphère privée, aux enseignants le devoir de faire découvrir l’altérité, l’intérêt collectif et le bien commun.
Or, une telle répartition des rôles a pu fonctionner sans grande difficulté et dominer l’enseignement public français tant que le corps social était prêt à reconnaître à l’État la légitimité absolue en matière éducative : au nom de la grandeur de la Nation et parce que les individus croyaient au bien-fondé des institutions qu’ils respectaient plus que tout. C’est ainsi qu’il y a encore trente ou quarante ans, on mettait son enfant à l’école un peu comme, aujourd’hui, on entre dans un avion : sans aucune velléité d’aller donner des conseils au pilote et, a fortiori, de contester sa compétence et son autorité… Mais les choses ont changé avec la montée de « l’individualisme social » qui domine aujourd’hui notre société : la confiance aveugle n’est plus là et, que ce soit dans le domaine de la justice, de la santé ou de l’école, on veut pouvoir contrôler qu’on est bien traité et exiger le mieux possible pour soi-même, ses proches et, bien sûr, sa progéniture. Rien d’extraordinaire dans ce phénomène, mais la volonté d’être considéré comme un interlocuteur à part entière, le refus d’être infantilisé et la revendication – renforcée par l’inquiétude liée aux crises sociale, économique et de l’emploi – de ne pas être sacrifié sur l’autel d’un « machine institutionnelle » aveugle. Rien d’étonnant à cela, dès lors que notre École n’a pas su transformer la démocratisation de l’accès en démocratisation de la réussite et que ceux et celles qui y sont maintenant accueillis sont d’autant moins assurés d’y réussir que, selon les dernières évaluations internationales, les écarts ne cessent de se creuser entre les privilégiés et les exclus. Rien de condamnable a priori dans cette évolution : d’ailleurs, les « républicains » les plus intransigeants se comportent dans ce domaine comme les « libéraux » les plus radicaux, les uns et les autres cherchant, tout « naturellement », à faire le mieux possible pour ne pas être victimes d’injustices et ne pas laisser leurs enfants ballotés au gré des circonstances, au risque de l’échec et de l’exclusion…
Face à ce phénomène, sans aucun doute irréversible, deux voies s’ouvrent à nous : ou bien l’État et son École sont capables de construire un nouveau « contrat scolaire » avec les parents, en reconnaissant une place à ces derniers, en leur permettant d’exercer, véritablement et de manière démocratique, leurs responsabilités de citoyens dans l’École, et cela sans trahir le projet scolaire lui-même de confrontation à la vérité et de construction du bien commun… Ou bien l’État et son École se crispent sur le fonctionnement passé et laissent alors les parents intervenir, de manière sauvage, selon les moyens dont dispose chacun, sur le fonctionnement d’une institution qu’ils considèrent comme un bastion imprenable, drapé dans son refus du dialogue et qui a trahi sa promesse de démocratisation de la réussite scolaire.
Or, force est de constater que nous n’avons pas réussi à élaborer un nouveau contrat entre l’école et les parents : ces derniers développent ainsi des comportements, plus ou moins acceptables socialement, qui révèlent leur sentiment d’exclusion et leur volonté, faute d’être associés au « pouvoir dans l’École », d’ « exercer le pouvoir sur l’école ». Ainsi, à côté des « consommateurs stratèges » – qui arpentent le système scolaire comme un supermarché en quête du meilleur rapport « qualité / prix » -, à côté des « quémandeurs polis » – qui savent doser leurs sollicitations pour obtenir satisfaction sans agacer les enseignants et les cadres éducatifs -, on voit apparaître, comme le montre bien le présent livre de Gorges Fotinos, les « contestataires agressifs » qui n’hésitent pas à remettre en question les principes de l’institution républicaine, l’autorité des directeurs et des enseignants – plus spécifiquement des « enseignantes », d’ailleurs -, qui vont au conflit sans scrupule avec les cadres éducatifs, contribuant ainsi à la dégradation du « climat scolaire » et, donc, à l’échec de l’école et de leurs propres enfants.
L’enquête que présente cet ouvrage dévoile l’ampleur du phénomène : les directeurs et directrices d’école y disent leur perception d’une situation qui apparaît particulièrement préoccupante. Le fossé avec les parents semble bien s’agrandir et, plus particulièrement, avec les parents des milieux populaires qui, tout à la fois, ignorent les codes de l’École et sont les premières victimes de l’échec de la démocratisation… Mais cet ouvrage ne doit pas, pour autant, nous faire basculer dans le pessimisme, ni, a fortiori, encourager le fatalisme. En effet, on y découvre aussi des éléments positifs : même s’ils sont relativement peu nombreux et à peu près toujours les mêmes, les parents, qui s’impliquent de manière constructive dans les écoles – en particulier à travers les « conseils d’école » et la construction de « projets éducatifs » – montrent qu’un nouveau contrat est possible, fondé sur la reconnaissance de la complémentarité des rôles et sur le travail collectif : il ne s’agit plus là de chercher individuellement à obtenir satisfaction pour ses propres enfants – ou à « régler ses comptes » par dépit de ne pas l’avoir obtenu -, il s’agit de poser les bases d’une « coéducation » entre citoyens qui se veulent ensemble responsables de l’éducation et de l’émancipation de toutes et tous. Il s’agit de chercher comment « faire réussir l’École » pour faire réussir tous les élèves et non plus de faire réussir ses propres enfants en se désintéressant de l’avenir de l’École. Il s’agit d’assumer la mission proprement pédagogique de l’École, sa rupture avec l’univers familial et la possibilité donnée à toutes et tous d’accéder à des savoirs rigoureux, à l’argumentation rationnelle et à la possibilité de la confrontation sereine avec les autres pour construire le bien commun. Mais il s’agit d’assumer cette mission, non pas contre les parents, mais avec eux !
De même, on voit bien dans cet ouvrage que les directeurs et enseignants, même s’ils estiment cet investissement chronophage – peut-être en raison du caractère isolé et relativement marginal de leurs initiatives dans ce domaine -, reconnaissent les bienfaits d’un véritable partenariat, quand on prend le temps de montrer ce que l’école peut apporter et en quoi elle constitue une occasion, pour chaque élève, d’apprendre, de grandir et de s’émanciper. Ils découvrent sans doute, à cette occasion, que la nécessaire rupture entre le milieu familial et le milieu scolaire ne peut s’effectuer dans le mépris ou l’humiliation ; ils observent que les parents comme les enfants ne peuvent dépasser que ce que l’on a reconnu et travaillé avec eux ; ils comprennent que l’on ne peut arracher un enfant à sa famille en lui imposant brutalement des comportements en contradiction avec son univers familial : cela ne ferait que susciter sa méfiance ou son hostilité, cela ruinerait le projet scolaire émancipateur lui-même. L’éducation est affaire de transition, de cheminement, d’accompagnement sur le chemin : tel est, d’ailleurs, l’étymologie du mot même de pédagogue : celui qui accompagne les enfants de la famille vers l’École, de là où il a émergé vers là où il pourra émerger et ainsi, selon la belle formule de Pestalozzi, « se faire œuvre de lui-même ».
Ainsi se dessine un avenir possible pour une École qui, sans renoncer à enseigner aux enfants « ce qui les réunit et ce qui les libère », le fasse avec l’engagement collectif des parents. Des parents qui soient entendus – ce qui ne veut pas dire nécessairement approuvés – quand ils évoquent leurs difficultés et témoignent de leurs incompréhensions. Des parents qui se sachent respectés et respectent ainsi leurs interlocuteurs scolaires. Des parents qui soient reconnus et « requalifiés », grâce à une interlocution positive avec les enseignants, pour échapper à la relégation systématique. Des parents qui ne vivent plus l’école comme une forteresse interdite, mais comme un lieu d’accueil et de réussite possible pour tous les enfants. Des parents qui voient dans l’accès de leurs enfants aux savoirs une chance possible pour la construction d’une société plus solidaire. Des parents qui assument tout autant leur rôle essentiel de filiation que le rôle pédagogique de l’École dans la construction de la démocratie.
Certes, rien de tout cela n’est facile. Là comme ailleurs, nous ne pouvons ni nous replier frileusement sur les recettes du passé, ni imaginer faire table rase de ce passé miraculeusement. Les relations entre l’École et les parents sont encore – et, sans doute, pour très longtemps, peut-être même pour toujours ! – assignées au conflit. Fort heureusement ! Car le conflit est le corollaire de la démocratie. Le conflit est la seule alternative au totalitarisme. Le conflit permet d’éviter l’enkystement d’un système qui sépare définitivement les élus des exclus. Le conflit remet les choses en jeu, rouvre les perspectives, recrée du lien… Mais le conflit n’est pas la guerre ! C’est la capacité à réfléchir collectivement sur les contradictions qui traversent les situations que nous vivons. C’est la capacité à expliciter nos désaccords et à construire des accords. Pied à pied. Modestement, sans que quiconque ne renonce à lui-même ni ne cherche à intimider l’autre.
Il faut nous réjouir d’être dans un pays et dans un temps où nul ne peut imposer arbitrairement sa vision du monde. Il faut nous réjouir de vivre dans une société où chacune et chacun est reconnu dans ses droits de citoyen. Il faut nous réjouir que plus personne ne puisse dire la vérité des autres à leur place, assignant la plèbe à l’obéissance et au silence… Mais il nous revient maintenant, si nous ne voulons pas risquer l’éclatement, si nous ne voulons pas voir les liens sociaux exploser sous la pression des intérêts individuels et des forces centrifuges de toutes sortes, de construire des institutions pour faire exister et contenir, tout à la fois, les conflits. Des institutions ouvertes à toutes et tous. Des institutions qui se donnent les moyens d’entendre chacune et chacun. Des institutions portées par des hommes et des femmes formés au travail en équipe, à la méthodologie de l’écoute et de la prise de décision. Des institutions qui ne se gargarisent pas de jargon technocratique mais sachent construire des projets qui rendent chacune et chacun fiers de leur engagement collectif. Des institutions qui soient au plus près des territoires et qui en intègrent toutes leurs composantes. Des institutions fondées sur la coopération et non sur la compétition effrénée pour en prendre le contrôle. Des institutions qui tissent ensemble un nouveau paysage politique et permettent de mettre en place un nouveau contrat entre les parents et l’École.
On le voit : il n’est que temps de se mettre au travail pour cela et il faut remercier Georges Fotinos de nous apporter, à travers ce livre, de précieuses analyses et de belles propositions pour avancer dans cette perspective.
Philippe Meirieu

